
Avril 2023 /
Réflexions autour de l’intelligence artificielle dans les métiers de la création.
______
L’IA déboule dans nos métiers de l’image. Fascinant les uns, horrifiant les autres. Si l’humain a une inclination naturelle pour tout ce qui est magique, il a surtout la responsabilité d’agir de manière éclairée et lucide. L’IA n’est pas magique et ses implications ne sont pas neutres. Voici une tentative de réflexion éthico-philosophico-économique sur un sujet bien trop contemporain pour emporter un avis définitif.
______
NB: Toutes les illustrations de cet articles ont été conçues en « milieu de journée » et non avec « midjourney ».
Crédit : Merci à mon associé Jérémie Fesson pour l’inspiration du titre de cet article 🙂

Les réseaux sociaux ont accompli la prophétie de Warhol, tout le monde sera célèbre mondialement pour 15 minutes. En attendant notre brève apothéose médiatique, nous travaillons depuis 20 ans à nourrir l’Ogre (cf. les GAFAM) de nos datas. Vies intimes exposées, récits dérisoires, événements minuscules et selfies aux UV factices. Nos goûts et nos préférences n’ont aucun secret pour leurs algorithmes.
Par cette recherche de l’attention, nous nous sommes transformés en producteurs de contenus. Le journaliste est devenu « content manager », les grand-mères sont « grand-reporters » et nos enfants « influenceurs ». Au moins le terme anglais « content » a le mérite de se lire comme « être content » en français, tandis que le terme « contenu » renvoie à l’idée de remplir des contenants. Les contenus seraient donc une matière informe et malléable qui épouserait les contraintes qu’on lui impose, bref de la bouillie. Les contenus ne sont pas des créations, car les créations ne peuvent se conformer, par principe. La création est sans limite, tandis qu’un contenu est limité. Parler à tour de bras de « création de contenus » est un non-sens.
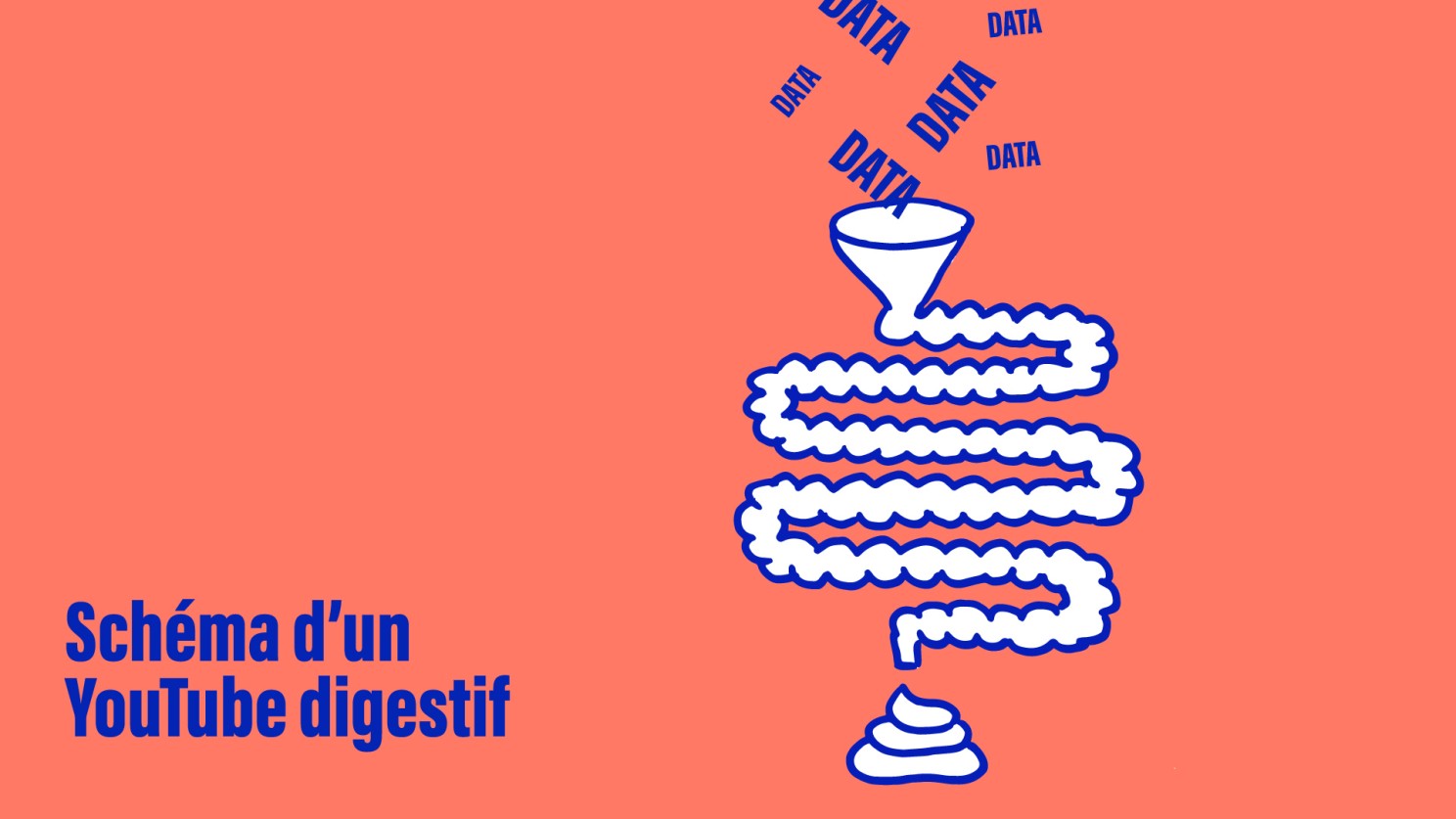
Les contenus sont idéaux pour les « tubes » (Youtube, Instagram, etc.). Ils circulent vite, s’ingurgitent contre quelques grammes de dopamine et se digèrent sans maux de tête. Si ces contenus sont de l’image, l’effet est encore plus rapide qu’avec du texte.
Effets collatéraux en pagaille. D’un côté, nous avons nourri l’ogre de pétaoctets de données préformatées. De l’autre, nous nous sommes rendus addicts aux flux d’images standardisées.
C’est là que la question de la valeur d’une image intervient : d’après le dicton populaire « une image vaut mille mots », mais mille images valent-elles un million de mots ?
Pour rappel, Les Misérables de Victor Hugo, c’est 513 000 mots. Une heure d’Instagram, c’est facilement mille images. Assurément divertissant, mais on repassera question enrichissement.
Dans le domaine des images, Toulouse-Lautrec n’a créé que 31 affiches durant sa carrière. Le chiffre semble ridicule en comparaison de la production frénétique d’un instagrammeur contemporain. Pourtant ces affiches valent de l’or.
Quelle valeur ont ces images ? Valeur historique, valeur d’usage, valeur symbolique, valeur économique, etc. Est-ce que cette valeur est définie par le temps passé pour produire ces images, la fameuse « valeur travail » de Marx ? Est-ce le temps passé à les regarder ? Est-ce l’empreinte laissée par ces images dans notre mémoire ? Est-ce leur utilité passée, présente ou future ?

Ce qui est évident, c’est qu’en tant que créateurs d’images, nous avons un intérêt vital à nous questionner sur la valeur économique de nos images. Les valeurs sociales et environnementales n’en sont pas moins importantes, mais la valeur économique reste primordiale pour tout créateur qui envisage de vivre de son art.
Dès lors, sommes-nous seulement des décorateurs d’écrans, des fournisseurs de « tubes », des abreuveurs de rétines ou encore des éleveurs d’ogres ?
Ou bien sommes-nous encore des auteurs munis d’un sens critique, d’une éthique et d’un « on ne sait quoi » supplémentaire, vous savez cet ingrédient irrationnel, profondément humain, que l’on nommera folie ou poésie. Tout cela nous permettant de créer des images qui font sens pour nos contemporains, des images qui produisent des effets, idéalement en forgeant des citoyens plutôt que des consommateurs.
Au fond, ce qui fait la valeur d’une image, c’est la rencontre entre l’intention singulière d’un auteur et la perception collective d’un public. C’est quand une image va développer en nous tout un imaginaire, quand l’œil s’autorise à lire entre les lignes et que le cerveau invente de nouvelles connexions. Ce sont ces images ciselées, singulières et polysémiques qui nous nous augmentent individuellement et nous réunissent collectivement, bref, des images qui fabriquent du commun et forgent de la « culture ».
À l’inverse, il y a des images prémâchées, stériles, fermées qui font rétrécir nos cerveaux et nous isolent. Images divertissantes (cf. le chat mignon), images angoissantes (cf. émeutes, catastrophes, violences, etc.), images pornographiques (cf. qu’on regarde en cachette depuis l’âge de 10 ans), images en boucles (cf. GIF animés, BFM TV).
Les ogres aiment les images stériles et futiles, car elles nous laissent du « temps de cerveau disponible » pour Coca-Cola et consorts. Time is money.
À ce stade, l’IA n’est pas encore intervenue.
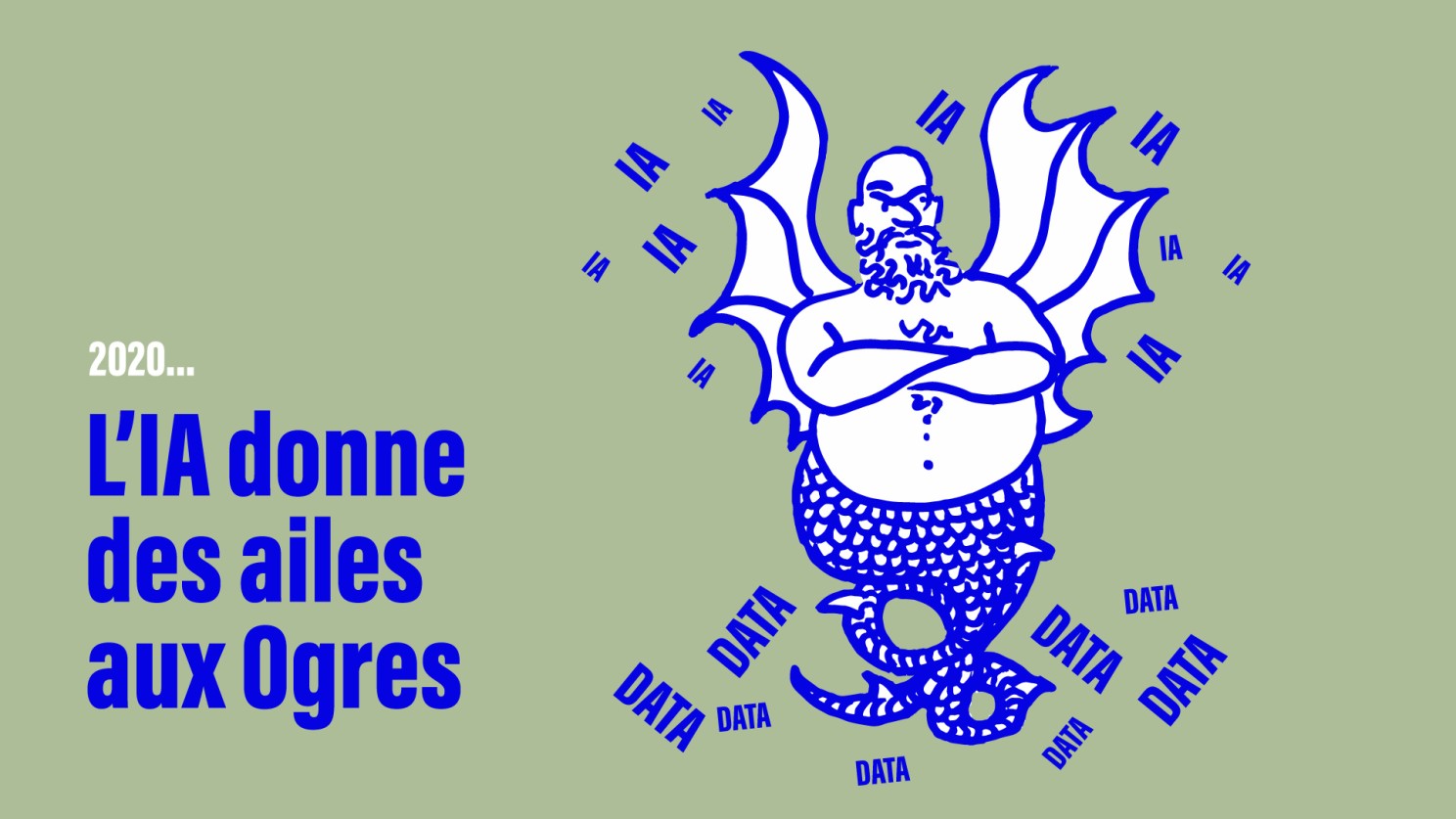
Dans les années 2020-2023, l’IA fait des progrès astronomiques. L’ogre Gafam doit se sentir pousser des ailes. Neuf milliards d’individus préformatés, dont on connait les désirs avant même leur naissance et l’IA qui va produire encore plus rapidement du contenu à coût quasi nul.
Le coût économique de création d’une image par une IA est équivalent à « 0,000-quelque chose € ». Chacun pourra alors s’abreuver d’images statistiquement plaisantes, techniquement ébouriffantes et complètement personnalisées à nos désirs formatés.
Les artistes, créateurs d’images singulières, qui ont toujours dû composer avec la mode et l’air du temps, pour trouver des issues sur le marché, se verront incapables de concurrencer le rythme et le faible coût des images issues du « machine learning ».
En admettant que le marché de l’image se soit infiniment élargi, ce qui est le cas. Certes, une image ne vaut pas grand-chose, mais le marché est devenu immense. La quantité d’images vendues devant possiblement couvrir la perte de valeur unitaire. Mais avec des IA entre les mains de quelques entreprises, cette manne financière de longue traine va passer des créateurs aux ogres-ailés (cf. Gafam + IA), dépossédant les créateurs de leur savoir-faire et de leur singularité, autant dire ce qui constitue à la fois leur raison d’être et leur gagne-pain.
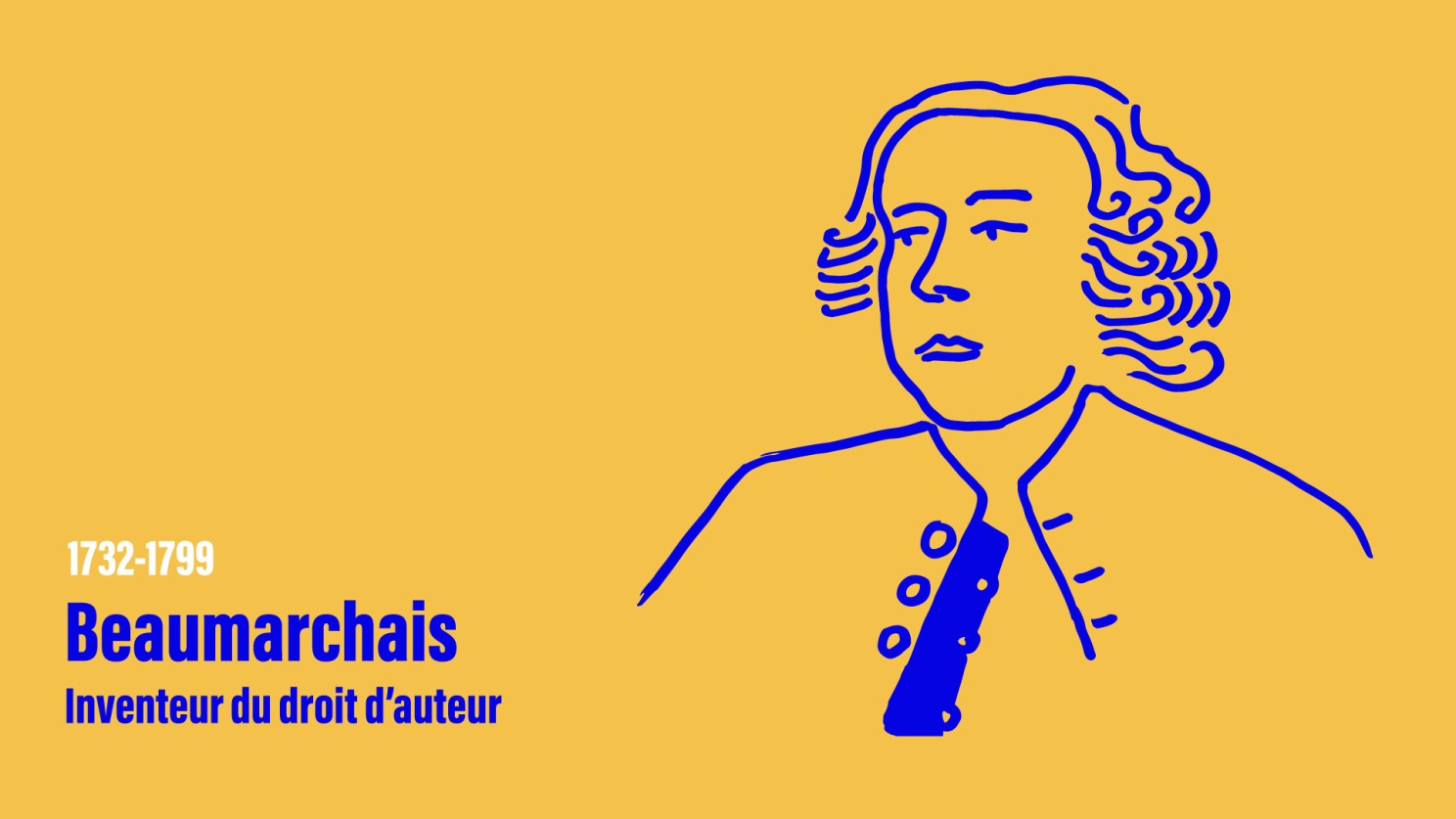
Reste le droit d’auteur. Invention formidable que l’on doit, entre autre, à Beaumarchais, qui fera promulguer en 1791 la première loi au monde pour protéger les auteurs, une loi qui offre aux créateurs un monopole économique temporaire (70 ans après la mort de l’auteur) sur leurs créations.
« Chat GPT écris-moi un roman de 513 000 mots à la manière de Victor Hugo » devrait vous exempter de payer des droits d’auteurs. L’exemple est mauvais, puisque Hugo est dans le domaine public. Mais vous avez saisi le sens du propos. Avec des algorithmes qui ont tout avalé, le style de Victor Hugo comme celui de n’importe quel artiste qui a le malheur d’avoir publié ses créations en ligne, la bouillie recrachée sera techniquement bluffante, mais restera de la bouillie sans auteur, donc sans autorité.
N’entendez pas le sens du mot « autorité » comme un synonyme de celui qui impose son « pouvoir de manière autoritaire (violente) », mais plutôt dans son étymologie originelle qui désigne le fait d’être auteur, c’est-à-dire fondateur, instigateur, garant ou responsable d’une œuvre. Sans auteur, il n’y a donc pas d’œuvre. Mais derrière l’œuvre, l’auteur et l’autorité, il y a cet ingrédient indispensable qu’est la confiance. L’IA va-t-elle nous priver de cet ingrédient fondamental pour faire société ?
Juridiquement, le statut de cette bouillie est encore trouble. Au mieux, les images générées sont libres de droits, au pire, c’est l’ogre-ailé le détenteur. De toute façon, pour les créateurs, à quoi bon essayer de se battre pour revendiquer des droits sur des images à « 0,000-quelquechose € ». Le jeu n’en vaudrait pas la chandelle. Une magnifique situation de concurrence déloyale pour les auteurs.
Le droit devrait a minima interdire la collecte des données sans notre consentement éclairé. C’est l’opt-in qui devrait prévaloir et non l’opt-out comme c’est le cas actuellement. Mais même avec ce changement, et puisque nous sommes déjà corrompus volontairement en acceptant les conditions générales abusives des ogres, renoncer à s’exposer sur les réseaux, reviendrait dans l’immédiat à un suicide social et économique. Alors le « style », cette surcouche de forme qui habille le fond, et qui est assurément la chose la plus facile à répliquer par les robots, ne sera-t-elle plus d’aucune utilité pour protéger les artistes ? Resterait aux artistes la responsabilité du fond. Précisément la partie qui n’est pas protégeable au titre des droits d’auteur. On peut protéger la matérialisation d’une idée, mais pas l’idée elle-même. Les concepteurs d’IA ont magnifiquement compris cette faille juridique.
Le seul bienfait de ces IA, à l’heure actuelle, est qu’elles ont besoin qu’on leur parle, qu’on leur écrive. Il nous faudra du vocabulaire pour les guider. Les écrivains généreront-ils des images plus intéressantes que les graphistes ? Probablement.
En tout cas, ce sera provisoire, le temps pour les ogres d’apprendre à s’auto-prompter pour devancer nos attentes.
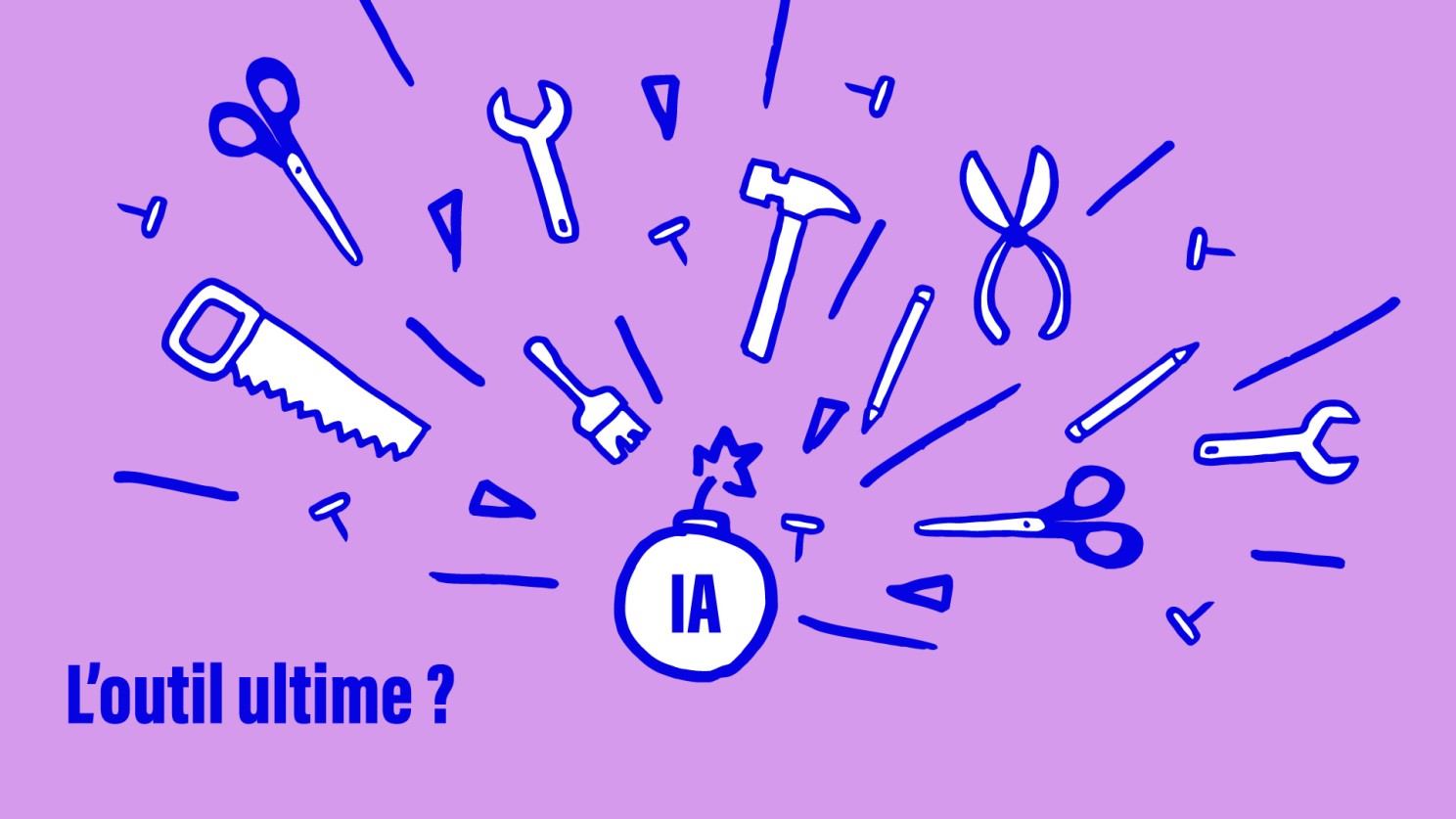
Dans les arguments des plus technophiles, l’IA est présentée comme un outil, un assistant. La métaphore avec l’avènement de la photographie au XIXe s. revient systématiquement comme argument. « La photographie n’a pas tué la peinture », entend-on. Cependant, un outil, on le maîtrise, on en est maître. Cadrage, temps de pause, objectifs, pellicules, développement, etc., le photographe maîtrisait ses outils. Aujourd’hui, qui peut prétendre maîtriser l’IA, quand on sait que les créateurs de ces intelligences artificielles sont incapables d’expliquer le fonctionnement de leurs inventions.
Avec l’IA le rapport homme-machine semble s’être inversé. L’IA aurait le goût et la couleur d’un outil, mais ne serait pas vraiment un outil pour l’homme ; à l’inverse, on peut légitimement se demander si l’homme n’est pas devenu un outil pour l’IA.
Oublions la valeur économique. Il y a aussi le plaisir de faire. Ce processus tangible qui procure au créateur une satisfaction immense, celle de toucher, malaxer, modeler la matière pour façonner ses idées. C’est assurément la même satisfaction que celle de l’ébéniste qui transforme un bout de bois en chaise. Un long processus, précieusement acquis par des années d’expérience (… et quelques bouts de doigts coupés pour les ébénistes !), qui devrait logiquement prodiguer ce précieux sentiment du travail accompli, cette dose de fierté indispensable à l’être humain.
Souhaitons-nous être dépossédés du plaisir de faire ? Faut-il se résigner à accepter de perdre cette part de notre fierté ?
Face à tout cela, on peut choisir d’ignorer et se soumettre, ou alors on peut se rebeller et combattre. Il est nécessaire d’ouvrir des contre-feux et de développer des contre-pouvoirs.
Interroger le champ du droit d’auteur pour défendre les créateurs. Lutter contre le monopole des acteurs de l’IA, réclamer toujours davantage de transparence.
S’enquérir de la casse sociale, des emplois perdus et s’assurer d’un haut niveau de protection sociale en retour. Former des citoyens éclairés et non des consommateurs-moutons. Réclamer des syndicats puissants.
Bref. On a du pain sur la planche.
Laisser un commentaire